parti travailliste
(en anglais Labour Party)

Parti socialiste britannique.
1. Un parti récent

C'est dans les vingt dernières années du xixe s. que la rencontre de plusieurs courants ouvriers et socialistes aboutit en Angleterre à la formation d'un nouveau parti politique. Depuis 1869, les syndicats britanniques s'efforcent de faire élire des députés ouvriers, qui se joignent au parti libéral. Pour satisfaire le souhait grandissant d'une représentation ouvrière indépendante est fondé en 1893 l'Independent Labour Party. En 1900 est créé le Labour Representation Committee (Comité pour la représentation du travail) qui prend en 1906 le nom de « parti travailliste ». Sa position d'arbitre entre les partis traditionnels (libéral et conservateur) lui donne une influence croissante.
2. Expériences et pratiques du pouvoir

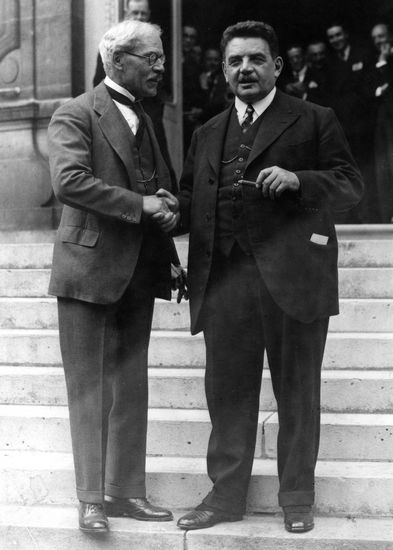
En 1918, il est réorganisé et devance par ses suffrages le parti libéral. Sous la direction de son leader, James Ramsay MacDonald, il est au pouvoir en 1924, puis de 1929 à 1931. À partir de 1935, inquiet de la politique des gouvernements totalitaires de Mussolini et d'Hitler, il soutient les efforts de l'État en faveur du réarmement. En 1940, il occupe des postes importants dans le gouvernement Churchill, et contribue avec énergie à la victoire commune. Au pouvoir de 1945 à 1951 sous la direction de Clement Richard Attlee, il réalise un vaste programme de réformes économiques et sociales, jetant les bases de l'« État providence ».
S'ensuit une période d'alternances au cours de laquelle conservateurs et travaillistes pratiquent des politiques de stop and go (restriction ou soutien de la demande et de la croissance) et développent le welfare state. Dirigé par Hugh Gaitskell de 1955 à 1963, le parti est de nouveau au pouvoir de 1964 à 1970 et à partir de 1974 avec Harold Wilson, puis de 1976 à 1979 avec James Callaghan. En 1979, à la suite de grandes grèves qu'il n'a su contenir malgré ses liens privilégiés avec les syndicats, dans un contexte d'essoufflement prolongé de la croissance, il est désavoué par les électeurs.
3. À l'écart du pouvoir : le parti travailliste sous le règne thatchérien

En 1980, Michael Foot, marqué à gauche, remplace J. Callaghan à la tête de la formation. En 1981, une partie des travaillistes modérés fondent le parti social-démocrate (SDP), bientôt allié au parti libéral. Sous la direction de Neil Kinnock, qui succède à M. Foot en 1983 après la sévère défaite de sa formation au scrutin général de la même année, le parti travailliste s'oriente vers une politique plus réaliste et connaît un certain redressement, qui se concrétise lors des élections européennes de juin 1984, plus modestement lors des élections législatives de juin 1987, et très nettement lors des élections européennes de juin 1989 (où les travaillistes devancent les conservateurs). Mais lors des élections législatives d'avril 1992, il subit à nouveau un grave échec. En juillet, John Smith succède à N. Kinnock. Sous sa conduite, le parti connaît un redressement notable. J. Smith meurt en mai 1994, peu avant la très large victoire de sa formation aux élections européennes de juin. Son successeur, Tony Blair, est élu en juillet. Sous l'impulsion de ce dernier, le parti travailliste rénove en 1995 ses statuts en abandonnant le principe de propriété collective des moyens de production et de distribution. Le vieux Labour Party devient le New Labour Party. À l'issue de son écrasante victoire aux élections législatives de mai 1997 (43,17 % des voix), Tony Blair devient Premier ministre.
4. Les nouveaux travaillistes au pouvoir : l'expérience blairiste
Dès lors, les nouveaux travaillistes mènent une politique économique orthodoxe qui accompagne la croissance, poursuivent la réforme de l'État providence, et s'emploient à moderniser les institutions du pays. T. Blair semble même venir à bout de l'épineux problème de l'Irlande du Nord. Le parti enregistre néanmoins, en dépit d'une forte abstention, un indéniable échec (28 % des voix) aux élections européennes de juin 1999 et son plus grave revers politique depuis 1987 lors d'élections locales en mai 2000. En revanche, sa victoire aux élections générales lui permet de conserver la majorité aux Communes (42 % des voix, et une avance de 165 sièges). Les projets de modernisation des services publics par leur ouverture aux capitaux privés et le partenariat Bush-Blair qui se forme à propos de l'Iraq à partir de la seconde moitié de 2002 suscitent au sein du parti des interrogations et des contestations qui toutefois ne vont jamais vraiment jusqu'à la dissidence. Les uns et les autres écornent l'aura jusque-là préservée du Premier ministre. De plus, ces orientations font l'objet de désaveux lors des élections partielles et, à nouveau, lors des consultations européennes et locales, qui se sont tenues en juin 2004 : avec 22,6 %, soit 19 eurodéputés, et 29 %, soit une majorité dans 39 conseils généraux sur 166, le parti enregistre un véritable étiage. Il n'empêche : malgré l'effondrement de la cote de popularité de celui qui reste, contre vents et marées, son leader, la formation remporte les élections générales de mai 2005, et conserve, avec 35,2 % des voix et 356 sièges, la majorité absolue aux Communes. C'est une victoire historique, car c'est la première fois que le pays accorde à trois reprises consécutives un mandat de Premier ministre à un candidat travailliste. Mais c'est aussi le score le plus faible réalisé par un parti au pouvoir depuis 1921.

T. Blair ayant annoncé qu'il ne solliciterait pas de quatrième mandat, la querelle de succession agite de plus belle les militants toujours moins nombreux et fragilise l'action d'un gouvernement tiraillé entre factions et moins sûr de ses troupes au Parlement. Dans ces différents cercles, beaucoup souhaitent voir le Premier ministre passer rapidement la main à son chancelier de l'Échiquier Gordon Brown, d’autant que le parti enregistre une perte de plus de 300 sièges aux élections locales de mai 2006, que les sondages donnent régulièrement gagnants les tories emmenés par leur nouveau et jeune leader David Cameron, et que T. Blair, plus impopulaire que jamais, souffre de son atlantisme, du fiasco irakien, et de son implication dans un scandale relatif au financement de la campagne de 2005. En septembre 2006, celui-ci rend publique sa décision de quitter le pouvoir avant la rentrée 2007, puis, après un mauvais résultat aux élections locales de mai 2007 (perte de 500 postes de conseillers sur les 10 000 soumis au vote, et notamment du contrôle de l'assemblée d'Écosse, pourtant vieux bastion travailliste), il démissionne de la tête du parti et du pays les 24 et 27 juin, laissant à G. Brown à la fois les rênes de l'un et de l'autre, ainsi que la tâche d'aller jusqu'à la fin du mandat et de regagner la confiance des électeurs.
G. Brown s'impose sans difficulté non seulement au sein de la formation, mais aussi dans l'opinion publique. La rupture tranquille qu'il opère lors des cent premiers jours de son gouvernement ainsi que l'impression de sérieux et de solidité qui se dégage de sa personnalité séduisent les Britanniques, au point de rallier nombre d'électeurs et de redonner une avance au Labour dans les sondages, toutes choses qui n'empêchent pas le Premier ministre de renoncer à provoquer à l'automne des élections législatives anticipées, à la stupéfaction générale et au grand dam de ses partisans. Cette décision qui jette le doute sur son leadership, associée au retournement de conjoncture qui se dessine et ébranle sa réputation de compétence, clôt les cent jours de lune de miel entre le pays et son principal dirigeant. Même s'il entreprend de désengager une partie des troupes d'Iraq, il ne parvient pas à retourner une opinion désormais majoritairement déçue et appelant de ses vœux le retour au pouvoir des conservateurs.
Ce contexte de morosité et d'incertitude, mais aussi de contestations et de divisions internes (notamment à propos de la politique fiscale du gouvernement) explique la déroute du Labour aux élections locales de mai 2008 : 350 sièges perdus, dont un symbole, Londres, 24 % des voix, le pire score obtenu depuis 41 ans pour ce genre de scrutin, et un recul au troisième rang sur l'échiquier politique national, non seulement derrière les tories (44 %) mais encore à la remorque des libéraux démocrates (25 %). Face à ce coup de semonce, de peur d'ajouter à la défiance générale, les députés font bloc derrière G. Brown aux Communes. Malgré la perte d'un énième bastion lors d'une élection partielle pendant l'été et de nouveaux remous au sein de l'appareil et de l'exécutif, le parti réuni en congrès annuel en septembre prend soin d'afficher sa solidarité avec le Premier ministre. Un mini remaniement au début d'octobre ajoute à l'impression d'union sacrée puisque d'éminentes figures du blairisme comme Peter Mandelson refont leur entrée au gouvernement. Il est vrai que la panique financière internationale qui frappe alors tout particulièrement la City n'incite guère les prétendants à la succession à se déclarer ouvertement et à défier G. Brown qui, en l'occurrence, fait une nouvelle fois la démonstration de son sérieux et de sa compétence. Sa gestion des débuts de la crise (plan de soutien au secteur bancaire, prises de participation de l'État dans de grands groupes financiers, puis programme de relance) rassure et vaut aux travaillistes la conservation inattendue d'un vieux fief écossais lors d'une partielle en novembre.
Mais l'embellie dans les sondages ne résiste guère à l'aggravation de la récession qui cristallise les mécontentements, multiplie les sources d'inquiétude et suscite une vive rancœur. Le Premier ministre, qui donne désormais l'impression d'être impuissant à lutter efficacement contre ses ravages, semble aussi devoir endosser, en tant qu'ancien chancelier de l'Échiquier, de surcroît proche des milieux d'affaires, une grande partie de la responsabilité de son déclenchement. Le scandale des notes de frais des parlementaires qui éclate à partir de mai 2009 sème la panique dans les rangs travaillistes et entraîne au sein du cabinet une série de démissions qui fragilisent le crédit de G. Brown. Les scrutins locaux et européen de juin constituent un nouveau désastre pour le Labour (perte de 290 conseillers et de 4 comtés pour le premier, 15,7 % des voix et une troisième position derrière l’UKIP pour le second) qui augure bien mal du résultat des prochaines élections générales. À nouveau, le parti se ressoude derrière son chef, qui choisit de revenir aux fondamentaux et de reconquérir l’électorat populaire du nord. Mais la permanence des dissensions internes et la piètre prestation du candidat Brown expliquent pour une bonne part la défaite que les travaillistes subissent en mai 2010 (29 % des voix, et 258 élus, le pire score depuis 1983) – cédant alors le pouvoir à une coalition conservatrice-libérale-démocrate.
5. Dans l'opposition
Comme le veut la tradition, le leader travailliste non reconduit au 10 Downing Street démissionne aussitôt de la direction du parti, ouvrant dès lors une bataille entre candidats putatifs à sa succession : les frères Miliband (David, l’aîné blairiste, centriste, donné favori, et Ed, fidèle soutier du Premier ministre en partance), deux autres membres du cabinet sortant (Ed Balls et Andy Burnham), ainsi que le député marqué à gauche John McDonnell puis Diane Abbott, elle aussi plus radicale que les 4 premiers challengers, et première femme noire à être élue aux Communes (1987). Contre toute attente, et en dépit ou peut-être en raison du soutien de T. Blair qui étrille son successeur à la tête du gouvernement dans ses Mémoires, David Miliband est battu de justesse (49,3 % des voix) au quatrième tour de scrutin interne à l’issue du congrès de la formation fin septembre. C’est donc son benjamin, Ed, soutenu par les syndicats, qui devient chef de l’opposition et compose un cabinet fantôme auquel son frère, qui décide de conserver son siège de député, renonce à participer.
Répudiant son surnom d'« Ed le Rouge », Ed Miliband met en avant l’héritage du New Labour, tout en regrettant publiquement l’engagement en Iraq. Ce faisant, il confirme l’importance de la régulation mais aussi du libre-échange et de l’économie de marché, et entend reconquérir le centre sans renier l’ancrage à gauche de son parti. Il se prononce en faveur de certaines coupes sociales et d’une réforme de l'État-providence, qui devra, selon lui, faire mieux avec moins. Mais il n’en demeure pas loin de soutenir la cure d’austérité drastique imposée au pays par la coalition lib-dem/tory au pouvoir, estimant que les efforts exigés ne sont pas assez également partagés et pèsent exagérément sur les classes moyennes et les milieux modestes. Les élections locales de mai 2011, auxquelles est associé le référendum en vue d’une modification du scrutin par l’addition d’une dose de proportionnelle pour lequel il ne s’engage que très mollement, confirment le parti, mais sans le plébisciter, comme principale force de l’opposition (37 % des voix, devant les conservateurs, et de nombreux gains de municipalités et de conseillers territoriaux, ainsi que l’obtention d’une quasi majorité dans l’assemblée du Pays de Galles).
Mais les travaillistes pâtissent avant tout de l’absence de leadership dans leurs rangs. Malgré les bons résultats électoraux et le redressement de la cote de popularité de la formation, Ed Milliband peine à imposer son autorité, tant dans les rangs du parti que plus généralement dans l’opinion. S’il se révèle comme véritable chef de l’opposition à l’éclatement du scandale News of the World au début de l’été 2011, et s’il affiche une fermeté qui plaît lors des émeutes urbaines du début août, il ne réussit ni à faire taire les contestations internes ni à inscrire son ascendant dans la durée. Et les nouveaux succès aux consultations locales de mai 2012 (une douzaine de grandes villes dont Birmingham, Liverpool, Cardiff, Southampton) ravies à la majorité tory/lib-dém comme les difficultés croissantes rencontrées par l’attelage au pouvoir ne semblent guère en mesure de changer à court terme la donne.
Le durcissement de la position du Premier ministre sur l’Europe et son engagement à organiser un référendum sur le maintien de la Grande-Bretagne dans l’UE après 2015 font en outre de la question un enjeu majeur pour les prochaines élections générales qui met les travaillistes dans l’embarras, et favorise la poussée de l’UKIP. Aux élections locales de mai 2013, bien que le parti arrive en tête et gagne près de 300 sièges de conseillers, il ne recueille que 29 % des suffrages, signe de sa difficulté persistante à susciter l’adhésion et a fortiori l’enthousiasme. Qui plus est, s’il conserve au même moment le siège de député abandonné par D. Miliband qui fait le choix de se retirer de la vie politique et de rejoindre une ONG américaine, il doit désormais également affronter la concurrence de ces populistes eurosceptiques, qui devancent les tories et les lib-dém. Les élections européennes et locales de mai 2014 confirment cette nouvelle donne : si le Labour arrive en tête des secondes, il n’obtient que 31 % des voix, soit deux points seulement de plus que ses adversaires conservateurs, alors même que la formation de Nigel Farage réalise un bon score à l’échelle de l’ensemble du pays, 17 %. Surtout, c’est cette dernière qui remporte les premières, avec 26,7 % des suffrages, devant les travaillistes (24,7 %) et les tories (23,3 %). Menacé jusque dans ses bastions par ces nouveaux venus de la politique et pénalisé par l’absence de charisme d’un chef toujours plus contesté en interne, le parti semble de fait mal engagé pour reprendre le pouvoir à un Premier ministre par ailleurs remis en selle grâce aux bons chiffres de l’économie…
En outre, l’union sacrée qui réunit à l’été 2014 les grandes formations britanniques dans une opposition conjointe à l’idée de sécession de l’Écosse fragilise les solides positions du Labour dans la province : si le SNP finalement perd le référendum de septembre et son pari de la faire alors accèder à l’indépendance, il renforce auprès de ses électeurs son identité de parti régional fortement ancré à gauche – de quoi tailler des croupières aux candidats travaillistes lors des prochaines échéances…
La campagne pour le scrutin général de mai 2015 s’engage. E. Miliband est à la peine : sa personne comme son programme ne rassemblent guère, voire, pis, suscitent de fortes réticences jusque dans l’appareil du parti. Le débat demeure terne, et se focalise longtemps sur le score et le rôle putatifs des petites formations, comme l’UKIP à l’extrême droite ou le SNP à gauche. Le choix tactique de la droitisation opéré par le Premier ministre, l’accent qu’il met sur l’impérieuse obligation de la rigueur budgétaire, sa proposition d’avancement d’une consultation populaire sur le maintien du royaume dans l’UE, dont seul parmi les formations le Labour ne soutient pas le principe, et la menace savamment distillée par l’état-major tory d’une majorité relative travailliste dépendante de l’appoint des élus indépendantistes écossais portent leurs fruits électoraux et étouffent le léger frémissement finalement perceptible dans le camp progressiste : contre toute attente en effet, les conservateurs remportent une victoire sans appel. E. Miliband et les siens en revanche essuient une sévère défaite : si, avec 30,4 % des voix, ils augmentent de près d’un point et demi leur résultat de 2010, ils voient leur contingent de députés réduit de 26, à 232, leur pire étiage depuis 1983 sous l’ère Thatcher. C’est avant tout le résultat de l’étiolement spectaculaire de leur bastion calédonien : sur les 40 sièges qu’il représentait, ils n’en sauvent qu’un seul, le SNP raflant pour sa part 56 des 59 circonscriptions de la province. Tirant la leçon de ce désaveu cinglant, E. Miliband démissionne de son poste de chef de parti.
Le virage à gauche et la question du Brexit
En septembre 2015, outsider issu de la gauche parlementaire du parti, député d’Islington North (Grand Londres) depuis 1983, Jeremy Corbyn prend la tête du Labour après avoir remporté, dès le premier tour, près de 60 % des voix des adhérents tandis que la candidate « blairiste » n’en obtient que 4,5 %. Aussi, malgré l’opposition d’une partie de l’appareil du parti et du groupe parlementaire, impose-t-il au Labour un tournant résolument marqué à gauche, prônant une franche opposition aux politiques d’austérité. Le projet de sortie du Royaume-Uni de l’UE divise cependant le Labour tout comme son adversaire conservateur. À cette question centrale s’ajoute, naissant peu de temps après son élection, une polémique lancinante sur l’antisémitisme dans les rangs du parti.
Prenant acte du fait que de nombreux électeurs travaillistes (environ 30 %) ont voté pour le « Brexit », lui-même partagé entre son hostilité à une Europe néolibérale et son soutien, timide, au maintien de son pays au sein de l’UE lors du référendum de juin 2016, le nouveau chef du Labour reste prudent au risque d’être accusé d’étouffer le débat. Opposé surtout à une sortie sans accord (« no deal »), il semble conforté par le succès du parti aux élections anticipées convoquées par Theresa May en juin 2017 (40 % des voix et 262 sièges). Tergiversant notamment quant à l’opportunité d’un nouveau référendum et s’opposant aux accords négociés avec Bruxelles, les travaillistes contribuent cependant à l’enlisement des discussions sur la sortie de l’UE.
L’ambiguïté n’est pas levée en 2019 alors qu’ils sont sanctionnés aux élections européennes avec 13,7 % des voix et lorsque le nouveau Premier ministre B. Johnson parvient, avec l’accord réticent du Labour, à obtenir de nouvelles élections anticipées afin de surmonter les blocages au sein du Parlement britannique.
Le parti se présente aux urnes avec un programme économique, social et environnemental alternatif assez radical. Prévoyant notamment un renforcement du secteur public, l’augmentation du salaire minimum et des impôts sur les revenus les plus élevés, une réduction du temps de travail et une « Révolution industrielle verte », ce programme est toutefois éclipsé par la question omniprésente du « Brexit ». La proposition travailliste d’obtenir dans un délai de trois mois un nouvel accord qui maintiendrait une relation étroite avec l’UE, puis de le soumettre à un référendum qui offrirait aussi la possibilité de rester dans l'UE, peine à convaincre un électorat arrivé à saturation, après trois ans de négociations.
Alors que les sondages montrent une chute de la confiance en J. Corbyn entre 2017 et 2019, le Labour obtient l’un des plus mauvais résultats de son histoire à l’issue du scrutin du 12 décembre 2019 avec 203 sièges et 32 % des suffrages, perdant des voix dans l’ensemble du Royaume-Uni, tandis que les conservateurs progressent dans des circonscriptions à dominante ouvrière et lui ravissent même plusieurs « fiefs » dans le Nord-Est et les Midlands. Alors que son adversaire s’impose surtout dans les circonscriptions les plus massivement favorables au « Brexit », le parti travailliste arrive tout de même en tête dans celles qui avaient voté en faveur du maintien dans l’UE, mais il y recule également au profit des Libéraux-démocrates.
Pour en savoir plus, voir l'article Grande-Bretagne : vie politique depuis 1979.










