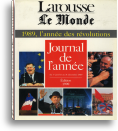La forme de Paris, croyait-on, était finie. On affirmait que Paris n'offrait plus de terrain. On s'était habitué à penser que le revirement giscardien avait définitivement clos l'ère moderniste de Georges Pompidou. Voici qu'une opération en cache une autre, en entraîne une suivante, dans un jeu de taquin où la valeur de chaque pièce flambe à la vitesse des prix parisiens.
Avec le libéralisme, l'État a perdu ses pudeurs d'antan. Il peut maintenant jouer au Monopoly. Libère-t-il les terrains du quai de Passy, qu'occupait le ministère du Logement et des Transports avant de partir à la Défense ? Il les vend et organise en sous-main un concours. La Défense elle-même n'est que ce jeu où deux partenaires, l'État et un promoteur privé, se disputent les bénéfices et les honneurs de la place. L'État monte l'opération des Collines (architecte Jean-Pierre Buffi), autour de l'Arche, pour rentabiliser son investissement. Christian Pellerin, à la tête de la Sari-Seeri, rachète le CNIT, le vide, le remplit de mètres carrés fructueux œuvres par Andrault et Parrat.
Ce n'est pas tout. Autour des nouveaux monuments s'édifient de grandes opérations. À peine achevé, le Parc de la Villette s'entoure de grands chantiers. Côté Porte de Pantin, la Cité de la musique, qui verra se déployer le talent de Christian de Portzamparc. Côté Porte de la Villette, les immeubles de Gérard Thurnauer. Et partout un cortège d'opérations immobilières.
La Ville de Paris, complice et accompagnatrice des opérations lancées par l'État sur ses terrains, n'est pas en reste. Le grand Est parisien verra se transformer les deux rives de la Seine, côté Tolbiac-Masséna, et côté Bercy, où un parc remplacera une partie des terrains où s'entreposait le vin. À l'Ouest, du côté du ponant, un autre parc, au centre d'une zone bourrée de nouveaux immeubles, à la place des anciennes usines Citroën.
Avec tout cela, les paysagistes, les architectes, français et étrangers, jeunes ou confirmés, trouvent leur bonheur. Mais tout cela fait-il un urbanisme ? Une grève de métro qui paralysa, l'hiver 1988-1989, les transhumances quotidiennes de millions de Parisiens et de banlieusards, répondit à la question. On découvrit que les deux systèmes qui se croisaient sur Paris, celui de l'État, qui déposait sur le carreau ses beaux monuments, et celui de la Ville, contrainte à rester cantonnée dans ses murs et à remplir ses mailles, ne suffisaient pas à raisonner le territoire.
L'Île-de-France est déséquilibrée entre l'Est, presque tout de logements, et l'Ouest, presque tout de bureaux, entre le Nord, trop pauvre, et le Sud, trop morcelé. Le casse-tête est d'autant plus difficile à résoudre que la régionalisation a donné sa caution aux initiatives particulières, qui ne veulent plus s'accommoder des nécessités qui les dépassent. Il ne suffit plus dans ces conditions de lancer des projets ponctuels. Cela se vit bien à la Défense. Y construire une nouvelle tour, fût-elle la plus haute du monde comme celle que propose Jean Nouvel sur le terrain de la Folie, ne peut rien pour ordonner les terrains chaotiques de l'après-Défense, sur lesquels elle empiète déjà. Roland Castro, avec Banlieue 89, l'association d'architectes 75021, ont lancé un cri d'alarme, émis des propositions, suggéré des méthodes. Mais la politique d'aménagement du territoire qu'ils appellent de leurs vœux semble bien finie. Les villes nouvelles, qui avaient vingt ans en 1989, n'ont pas rééquilibré le Grand Paris. L'urbanisme reste à inventer.
La folie des grandeurs
La presse française et étrangère ne s'est pas fait faute de brocarder la politique des grands travaux menée à Paris. Le président de la République fut tour à tour traité de pharaon ou d'amateur d'Albert Speer, l'architecte de Adolf Hitler. Ses détracteurs fustigeaient ainsi le goût du monument et le désir d'éternité qu'ils lui supposaient. Force est pourtant de reconnaître que les projets parisiens font figure de jouets à côté de réalisations autrement plus grandioses entreprises aux quatre coins du monde.