équivalent mécanique de la calorie (suite)
D’autres mesures plus précises sont dues à Henry A. Rowland (1880), puis à Constantin Miculescu (1892) : l’axe à palettes du calorimètre est entraîné par un moteur pour lequel on mesure au cours de l’expérience le couple moteur Г et la vitesse de rotation N tr/s ; d’où la puissance du moteur P = Г . 2π . N et le travail W = Г . 2π . N . x, x étant la durée de l’expérience. Le calorimètre de Miculescu était à écoulement permanent d’eau ; celle-ci entrant à t1 °C et sortant à t2 °C, et m étant la masse d’eau écoulée pendant le temps x, on a q = m . c . (t2 – t1), c étant la chaleur massique moyenne de l’eau dans l’intervalle t1, t2.
D’autres mesures ont été faites, qui utilisent l’effet Joule : on mesure dans un calorimètre la chaleur q dégagée par le passage d’un courant de I ampères dans une résistance immergée de R ohms pendant x secondes ; on a W = R . I2 . x joules et q = μ . θ.
Il n’est pas inutile de faire remarquer que des expériences ont également été faites par Gustave Adolphe Hirn, de 1854 à 1875, sur des machines à vapeur industrielles pour mesurer J au cours de cycles où, cette fois, disparaît de la chaleur et apparaît du travail ; moins précises, ces expériences ont, cependant, fourni la même valeur de J que les précédentes. Signalons enfin le calcul de J fait par J. Robert von Mayer (1842) en utilisant la relation
J . M (Cp – Cv) = R,
qui, depuis, porte son nom (v. gaz).
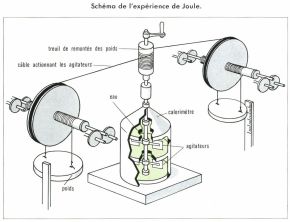
Résultats
La valeur actuellement admise comme la plus précise est J = 4,185 5 joules par calorie. Elle fixe la valeur de la calorie, unité hors système, par rapport au joule, unité légale, mais aussi par rapport à une autre unité hors système très utilisée, le watt-heure (3 600 joules) : 1 cal = 1/860 Wh.
Remarque
Dans les exposés modernes de thermodynamique, on a supprimé J des formules. On écrit par exemple W + Q = 0 pour un cycle, car W et Q sont supposés exprimés à l’aide de la même unité d’énergie, le joule ; mais la connaissance de la valeur de J est quand même nécessaire, car on utilise volontiers, en calorimétrie et en thermochimie par exemple, la calorie comme unité.
R. D.




