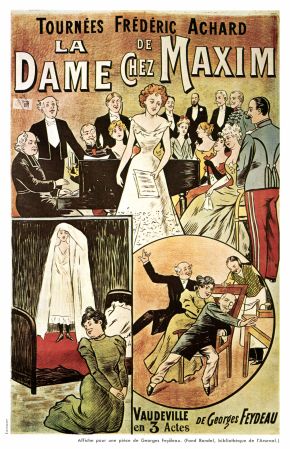Mouvement spirituel catholique du xiie s., condamné et combattu par les autorités ecclésiastiques pendant trois siècles, et, après son adhésion à la Réforme du xvie s., nerf du protestantisme italien actuel.
Un mouvement « d’Église »
Au pied de la statue qui, à Worms, commémore la comparution héroïque de Luther devant la diète impériale en avril 1521, Pierre Valdo est assis. Les protestants voient donc en lui un de ces précurseurs qui, deux siècles avant Wycliffe* et Hus*, annoncent le grand bouleversement, les recherches et les ruptures du xvie s.
En fait, la réalité est différente : Valdo et ses disciples forment une sorte de tiers ordre ; ils sont les ancêtres de ce qu’on appelle aujourd’hui « groupes informels » ou « communautés de base », avec un accent très fort sur la nécessité d’évangéliser. Un inquisiteur anonyme parle ainsi de leur mouvement : « L’origine des Pauvres de Lyon se situe aux environs de 1170. Un certain Valdesius (d’où le nom de vaudois), un homme riche, quitte ses biens et se propose de pratiquer la pauvreté et la perfection évangélique comme les apôtres. S’étant fait traduire les Évangiles et quatre textes de la Bible en langue vulgaire, il se mit à les lire de façon assidue sans toutefois les comprendre : il usurpa de cette façon les prérogatives de l’apostolat, et, dans sa présomption, il osa prêcher l’évangile dans les rues et sur les places [...]. Ayant de nombreux disciples, il les envoyait prêcher [...] quoiqu’ils fussent ignorants et analphabètes [...]. L’archevêque les mit en garde contre cette présomption, mais ils refusèrent de lui obéir, répondant que Dieu a donné l’ordre de prêcher l’évangile à toute créature [...]. Désobéissant et contumaces, ils furent excommuniés et chassés de la ville [...]. »
L’adversaire voit bien de quoi il retourne et, avec un flair étonnant, il s’attache plus à l’activité du groupe qu’à la personne de son fondateur. Certes, il y a un initiateur, mais le mouvement ne dépend plus de lui : il s’agit d’une expérience communautaire, de la vie d’un groupe d’hommes qui se met à pratiquer rigoureusement l’évangile et à réfléchir sur ce qu’implique le style de vie qui est le sien. Valdo lui-même n’est qu’un des membres de la fraternité originelle, en aucun cas un maître spirituel ou un « saint laïc » et, pas plus, le chef d’une dissidence chrétienne. À sa mort, son souvenir s’estompera très vite ; à peine une dizaine d’années après, Valdo sera considéré simplement comme un des premiers évangélistes de la famille spirituelle à laquelle il a donné son nom...
Loin d’être des hérétiques, en ce siècle cathare, les vaudois entendent rester dans la communion de l’Église, dont ils confessent et signent les symboles ; ils se veulent « d’Église », dirait-on aujourd’hui. Leur ambition est de mettre celle-ci « en état de mission » : ils se définissent comme compagnons (socii), membres d’une societas, sorte de corporation spirituelle à l’instar des corporations des artisans et marchands, auxquelles nombre d’entre eux appartiennent. Leur but : annoncer le salut, inviter les hommes à la repentance et aux bonnes œuvres, proclamer le Royaume et la nécessité de la conversion. Rien que d’orthodoxe en tout cela, mais, d’un coup, la foi devient vivante, parce que vécue. Les témoins attestent la réalité de ce qu’ils prêchent en payant le prix : l’abandon de leurs biens, la renonciation à toute richesse et, déjà, l’intuition que seule une Église « servante et pauvre » peut être signe de l’insondable richesse de la grâce.
Des pauvres qui inquiètent
Ils s’en vont donc, deux à deux, pieds nus, par les ruelles du bourg Saint-Nizier, sur les places publiques et les marchés, illustrations vivantes de la pauvreté du Christ ; ils sont « vêtus de laine grossière, nus sur les pas d’un Christ nu », dira un prélat romain. Ce qui va susciter l’inquiétude du magistère, ce n’est pas ce défi qu’ils lancent à tant de princes de l’Église et du siècle, à tant de laïques et de moines opulents, mais bien l’extraordinaire liberté qui est la leur, liberté missionnaire, liberté d’invention spirituelle, liberté des mendiants d’un Esprit qui ne se laisse ni enchaîner ni programmer. Leur pauvreté n’est ni une vertu, ni une mortification ; elle est le moyen, le support, l’expression de l’obéissance à la mission qui leur est confiée.