Maurice Barrès

Cet article est extrait de l'ouvrage Larousse « Dictionnaire mondial des littératures ».
Écrivain et homme politique (Charmes, Vosges, 1862 – Neuilly-sur-Seine, 1923).

Après des années difficiles dans un collège religieux, Barrès entre à l'internat du lycée de Nancy, où il passe le baccalauréat. À 20 ans, il est à Paris pour suivre des cours de droit mais il fréquente surtout les milieux littéraires. Bien qu'il soit nourri du rationalisme de Renan et de Taine, il pose au dandy, que séduit le « nihilisme contemporain ». Ces contradictions sont en partie dépassées dans la trilogie du Culte du moi : Sous l'œil des Barbares (1888), Un homme libre (1889), le Jardin de Bérénice (1891). Écrits sous l'influence de P. Bourget et de Stendhal, ces livres sont le récit d'expériences tentées pour développer la conscience personnelle : l'égotiste élabore une méthode originale, faite d'un mélange de spontanéité sensible et de jugement intellectuel, « afin de sentir le plus possible en analysant le plus possible ». Ses méditations intérieures, enveloppées de mélancolie, Barrès les présente avec un raffinement d'esthète mais assez lucidement pour nous prévenir que sa préciosité reste « railleuse d'elle-même ». « Soyons ardents et sceptiques » est un conseil qu'il suivra toute sa vie.
Cependant, il a très jeune l'ambition de faire carrière en politique. Après un premier échec, il est élu député boulangiste à Nancy, en 1889. Puis, comme candidat nationaliste, il échoue cinq fois de suite. En 1906, c'est la gloire : il est élu à l'Académie et député à Paris ! La politique ne sera jamais pour lui un divertissement – comme il l'a laissé croire – mais une activité à laquelle il s'est consacré avec passion : la plupart de ses œuvres sont autant d'interventions directes dans l'actualité politique.

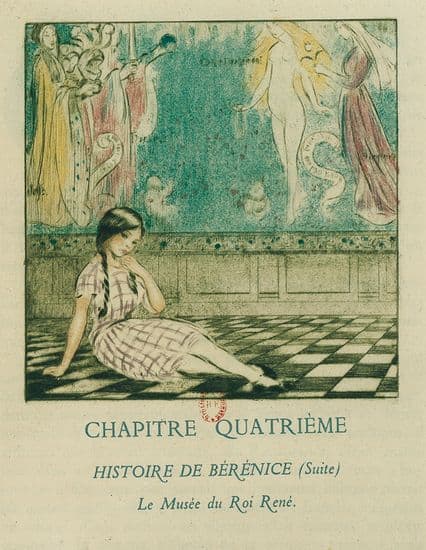

Son engagement est fondé sur une doctrine très cohérente qui apparaît d'abord dans la trilogie du Roman de l'énergie nationale : les Déracinés (1897), l'Appel au soldat (1900), Leurs figures (1902). Seul le premier est un vrai roman ; ensuite, bien qu'on retrouve les mêmes personnages, le récit se transforme en pamphlet. Les déracinés sont ces lycéens de Nancy que Bouteiller, leur professeur de philosophie, « ivre de kantisme », a poussés à continuer leurs études à Paris. Les mieux armés socialement supportent d'être arrachés à leur sol et à leur milieu social mais, pour les boursiers, l'échec est total : l'un deux, devenu criminel, finit guillotiné. La démonstration est donc sans nuance ! Mais Barrès réussit, par une mise en scène impressionnante, à hausser le débat d'idées, quand il évoque Napoléon, « ce carrefour d'énergie » ou V. Hugo, « la plus haute magistrature nationale ». À partir de 1898, il est parmi les plus violents antidreyfusards. Il pratique un antisémitisme effréné et lance des attaques ignobles contre ses adversaires. Pour lui, il n'existe pas de vérité en soi, seulement des vérités relatives et donc, à propos de Dreyfus, la raison d'État l'emporte sur toute autre considération. Suivant Taine, et surtout Le Bon et J. Soury, il affirme que l'individu, la nation sont strictement déterminés par l'appartenance à une race, à une histoire : « Nous repassons tous dans les pas et la pensée de nos prédécesseurs. » Le culte de la terre et des morts (1899) succède au culte du moi. Bien qu'il n'ait pas la foi, Barrès a été un défenseur ardent de l'Église contre la laïcisation de l'État, mais il reste républicain. À partir de 1914, il a soutenu à fond la politique de l'Union sacrée par des articles quotidiens qui sont aujourd'hui illisibles.
La Colline inspirée (1913) est un véritable roman poétique, celui d'un prêtre qui, sur la colline de Sion, un de ces « lieux où souffle l'esprit », rétablit un vieux culte abandonné. Mais son égarement mystique le fait condamner par l'Église. Sauvé par le dévouement d'un autre prêtre, il peut revenir au sacerdoce. À travers ce drame, c'est l'opposition entre l'esprit de liberté, d'inspiration, et « la règle, l'autorité, le lien » que Barrès voudrait dépasser. La fascination qu'il a toujours eue pour l'Orient se retrouve dans le Jardin sur l'Oronte (1922) : l'amour d'un chevalier chrétien pour une sarrasine, dans la Syrie des croisés, est racontée comme une violente histoire de volupté et de mort. Ce récit lyrique d'une passion hors des normes a surtout scandalisé ses amis politiques... Dans ses Cahiers – des notes prises de 1896 à 1923, – il est d'une grande sincérité avec lui-même. Il n'affecte pas son émotion pour évoquer sa mère ou son fils ; il sait dire la grandeur de Jaurès ou de Clemenceau qu'il a tant combattus. Mais il reste contraint, limité par le déterminisme qu'il s'est inventé : il ne fait pas d'effort pour connaître les écrivains plus jeunes. Au contraire, ses rêveries, soutenues par une prose admirable, ont encore de longues résonances.












