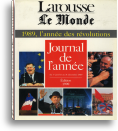Grâce à la PCR, qui permet de déceler un seul virus dans une population de plusieurs dizaines de milliers de cellules, une équipe de médecins américains mettait ainsi en évidence, courant 1989, que la séropositivité détectée par les tests de dépistage du Sida (tests basés sur la présence d'anticorps) apparaissait, dans la plupart des cas, plusieurs mois (six en moyenne) après la contamination par le virus. Elle recommandait de ce fait, en cas de risque potentiel d'une contamination récente, d'associer la méthode PCR aux techniques de dépistage traditionnelles.
En collaboration avec l'organisme national de recherche scientifique australien (CSIRO), le groupe français Limagrain développe depuis l'été 1989 les applications commerciales d'une nouvelle famille de molécules biologiques, appelées « ribozymes ». Découvertes en 1987 par deux biologistes du CSIRO, ces molécules sont des fragments d'ARN (acide ribonucléique), l'un des supports de l'information génétique ; mais des ARN très particuliers, capables, à l'instar des enzymes (d'où le nom de « ribozyme »), de catalyser des réactions biochimiques, et plus précisément de désactiver certains gènes, portés par d'autres molécules d'ARN que les ribozymes reconnaissent comme cibles et détruisent sélectivement.
L'immense intérêt de ces molécules réside dans le fait qu'une fois insérées dans un gène elles vont pouvoir s'attaquer à lui et à lui seul. Grâce aux techniques du génie génétique qui permettent aujourd'hui de modifier presque à volonté l'enchaînement naturel des séquences génétiques, on peut ainsi imaginer transformer ces ribozymes en toutes sortes de catalyseurs spécifiques. Ces derniers, une fois introduits dans le génome d'un organisme vivant, pourraient bloquer spécifiquement et durablement l'activité de n'importe quel gène. On imagine aisément les perspectives ainsi offertes, tant en agronomie que pour le traitement des maladies héréditaires.
Forcer la nature
Sur les milliers de gènes impliqués dans des maladies humaines, seulement quelques dizaines, pour le moment, ont été identifiés, isolés et clones (transférés dans une autre cellule) dans un système in vitro permettant de les étudier ; mais on peut prévoir, cartographie génétique et nouveaux outils moléculaires à l'appui, que ces cas encore trop rares se multiplieront rapidement. Lorsque cette « banque » de gènes pathologiques sera suffisamment riche, la possibilité de dépister (notamment en période prénatale), voire de corriger à l'échelle moléculaire le patrimoine génétique de tissus malades ouvrira à la médecine de gigantesques perspectives qui concerneront, à terme, des millions de vies humaines. Le traitement des maladies sanguines sera vraisemblablement le premier à en bénéficier, car la moelle osseuse (où prennent naissance les cellules du sang) est relativement facile à extraire, puis, une fois le gène sain greffé dans les cellules malades, à réinjecter dans l'organisme.
Tout cela n'ira pas, on le devine, sans poser de graves questions éthiques. La science (et la biologie plus que toute autre discipline) va aujourd'hui plus vite que la morale. À tort ou à raison, l'homme s'est donné les moyens de forcer la nature ; d'ores et déjà, la procréation médicalement assistée, dont l'essor ne s'est pas démenti depuis dix ans, pose à l'humanité de redoutables problèmes – tant juridiques que moraux.

Le statut de l'embryon humain
Depuis la naissance d'Amandine, le premier bébé-éprouvette français, en février 1982, le nombre de couples stériles ayant recours à la fécondation in vitro est en augmentation constante. En France, pour la seule année 1988, cette technique aura permis d'enregistrer 3 500 grossesses – soit, compte tenu du nombre de grossesses multiples qu'elle entraîne, de donner naissance à 3 800 enfants. Insémination artificielle et conception en éprouvette confondues, on estime aujourd'hui que 7 % environ des naissances sont ainsi issues des techniques de procréation médicalement assistée. Or, sur 45 000 embryons humains obtenus chaque année en France par fécondation in vitro, 10 000 d'entre eux environ, considérés comme excédentaires, sont conservés par congélation. Une situation capable de créer des scénarios résolument contre nature, que leurs effets pervers, ces dernières années, ont bien souvent transformés en de véritables imbroglios juridiques et moraux.