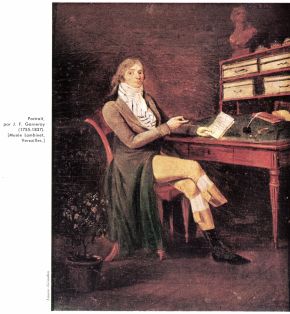Le mot talmud, qui signifie « étude », est peut-être l’abréviation de l’expression talmud Tora (étude de la Tora [Torah], c’est-à-dire de la Loi). Dans son acception la plus restrictive, il désigne les deux collections, palestinienne et babylonienne, de commentaires et de discussions (d’abord oraux, puis mis par écrit), édifiés autour d’un ouvrage antérieur, la Mishna ; rédigé vers 200 apr. J.-C., ce dernier ouvrage résume lui-même et met en forme la tradition orale d’explication et d’application de la Torah de Moïse, tradition aussi ancienne que la révélation, mais dont la manifestation certaine apparaît vers 300 av. J.-C. Dans la tradition juive, cette « Loi orale » (Tora she-be-al-peh) est inséparable de la « Loi écrite » (Tora she-bi-khetab).
Le Talmud est donc l’étude de la Torah écrite et orale, la recherche de sa signification la plus authentique et de la manière la plus autorisée de la mettre en pratique ; elle porte aussi sur les vues théologiques, l’éthique et une certaine conception de l’histoire nationale. La tradition veut que la Loi orale ait été révélée par Dieu à Moïse, en même temps que la Loi écrite, et qu’elle ait été, pendant des siècles, l’objet d’une transmission orale, notamment par les Prophètes. Son existence et sa nécessité sont postulées par l’examen du texte sacré, qui fait, lui-même, allusion à des révélations non consignées dans la Torah, et ne donne, au sujet des usages observés, que des principes généraux dont l’application détaillée, connue de tous, suppose une autre source d’information.
Les origines
L’exil de Babylone (587/86-539 av. J.-C.) et l’époque de la reconstruction qui le suivit furent particulièrement propices à la méditation et à l’enseignement de la « Loi orale », qui furent le fait des soferim (scribes). Ceux-ci s’imposèrent à l’attention du peuple lorsque, à cause de la destruction du premier Temple et de l’éloignement de Jérusalem, les prêtres eurent perdu certaines de leurs attributions. Il n’est cependant pas exclu que, par la force des choses, beaucoup de ces soferim se fussent recrutés dans le milieu sacerdotal, tant à Jérusalem qu’à Babylone ; ce fut le cas du sofer Esdras (ou Ezra) ; venu de Babylone, il répandit à Jérusalem la connaissance des préceptes de la Torah, dont il fit faire des commentaires publics au cours d’imposantes cérémonies ; les commentateurs étaient des interprètes accrédités. Le récit qui relate cet événement postule l’existence d’une interprétation orale officielle de la « Loi écrite ».
Celle-ci faisait, apparemment, l’objet d’un enseignement que les « membres de la Grande Synagogue » — sorte d’assemblée nationale dotée des pouvoirs civils et religieux — veillèrent à instaurer et à développer. Ils auraient été au pouvoir, si l’on en croit d’invérifiables traditions, entre l’époque d’Esdras (v. 428 av. J.-C.) et l’occupation de la Palestine par les monarques séleucides (198 av. J.-C.). On ne sait d’eux que peu de chose, sinon qu’ils demandaient la multiplication des étudiants de la Torah et l’édification, autour d’elle, de « haies protectrices », sous forme de règlements annexes dont l’observance garantirait l’inviolabilité des grands principes. Parmi les derniers membres de cette assemblée, on cite Siméon le Juste et ses disciples, Antigone de Sokho, Yosse ben Yoezer et Yosse ben Yohanan.
Au temps des Séleucides, les affaires publiques intérieures furent dirigées par un conseil d’anciens, ancêtre de ce que l’on appellera, plus tard, le Sanhédrin.
Sous le règne des rois asmonéens (134-37 av. J.-C.), issus de la résistance aux Séleucides, la dévotion à la Torah, écrite et orale, trouva son expression dans l’idéal des pharisiens, pour lesquels les affaires de l’État devaient se régler selon la Loi orale, dont les interprétations du texte écrit pouvaient permettre les ajustements nécessaires aux besoins du temps.
Pendant l’occupation romaine (37 av. J.-C. - 135 apr. J.-C.), les pharisiens ne se mêlèrent pas de politique ; dans l’attente d’une libération qui, pour eux, ne pouvait être que messianique, ils se consacrèrent exclusivement à l’étude de la Torah. Ils avaient alors, pour chefs, Hillel et Shammaï. Hillel venait de Babylonie ; Shammaï était de Jérusalem. Mettant en œuvre certains principes d’exégèse des textes, Hillel put faire adopter des institutions qui permettaient d’adapter valablement la Loi à la situation du moment. Shammaï est réputé pour avoir montré moins de souplesse. Leur méthode respective fut perpétuée par leurs disciples (qui ne furent jamais hostiles les uns à l’égard des autres), membres de la « Maison de Hillel », ou de la « Maison de Shammaï ». Les pharisiens furent le seul parti qui survécut à la destruction de Jérusalem par Titus, en 70 apr. J.-C. La notion de la « Loi orale », à laquelle ils s’étaient attachés, leur permit de s’adapter à la situation nouvelle. Le plus résolu d’entre eux fut Rabban Johanan ben Zakkaï, disciple de Hillel, qui avait clandestinement quitté la capitale assiégée ; on raconte qu’il sollicita, et obtint, de l’empereur l’autorisation d’installer, à Yabne, son école. Cette petite ville devint le centre spirituel du pays ; le Sanhédrin s’y établit. On prit un certain nombre de mesures, qui donnèrent à cet organisme la dimension d’une autorité religieuse centrale, non seulement pour la Palestine, mais même pour toute la Diaspora. Son chef, le nassi, finit par devenir, devant l’autorité romaine, le représentant accrédité de la nation. Le premier nassi fut Rabban Gamaliel, descendant de Hillel. Le Sanhédrin de Yabne eut à mettre en ordre la masse des traditions et des interprétations qui s’étaient accumulées. Il dut aussi résoudre, définitivement, les divergences qui avaient pu naître, et, avant toutes, celles des écoles de Hillel et de Shammaï. Cela se fit aux voix.